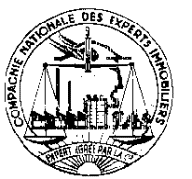CHARTE
DU DIAGNOSTIC AMIANTE
tel
que découlant des Décrets 96.97 du 7 février 1996 modifié
- relatif à la protection des occupants
(à titre passif) des immeubles bâtis -
________
et
du Décret 96-98 du 7 février 1996
-
relatif
à la protection des travailleurs –
Document établi sous la responsabilité technique de Philippe LAMY
Membre du Haut Collège International des Experts, GENEVE
Vice-président de la Compagnie
Nationale des Experts Immobiliers,
____________________________
Pour toute
suggestion ou demande d’explication complémentaire,
appeler le secrétariat de la Compagnie (ou Philippe LAMY, au 0144 071
957).
Sommaire
..... INTRODUCTION
.............................................................................................. ![]()
1.1
- RECHERCHE DE
L’AMIANTE / Décret 96-97 modifié..... ![]()
(dans flocages, calorifugeages et faux
plafonds) –
PHASE 1 .................................................................................................................... ![]()
1.1.1. Entretien préalable ......................................................................................... ![]()
1.1.2. Inspection visuelle ........................................................................................... ![]()
1.1.3. Prélèvements .................................................................................................. ![]()
1.1.4. Analyse qualitative des prélèvements ............................................................ ![]()
1.1.5. Rapport .............................................................................................................. ![]()
1.1.6. Mise en garde ................................................................................................... ![]()
1.2 - ETAPES ULTERIEURES.................................................. ![]()
PHASE 2 .................................................................................................................... ![]()
1.2.1. Détermination des zones homogènes ......................................................... ![]()
1.2.2. Critères d’évaluation de l’état de conservation ........................................... ![]()
1.2.3. Obligations inhérentes à l’évaluation ............................................................ ![]()
PHASE 3 .................................................................................................................... ![]()
1.3.1. Mesures d’empoussièrement ....................................................................... ![]()
1.3.2. Organismes habilités à procéder aux prélèvements d’air dans les
immeubles bâtis ................................................................................................ ![]()
1.3.3. Conditions de prélèvement ........................................................................... ![]()
1.3.4. Comptage des fibres d’amiante ................................................................... ![]()
1.3.5. Obligations
inhérentes aux résultats des mesures d’empoussièrement ![]()
2.1
- OBJET DE LA PRESENTE CHARTE,
relative au Décret 96-98 ![]()
2.2
- RECHERCHE ETENDUE DE L’AMIANTE / Décret 96-98. ![]()
2.2.1. Diagnostic 96-98 (1ère Phase) ...................................................................... ![]()
2.2.2. Diagnostic 96-98 (2ème Phase avant travaux) ............................................. ![]()
2.2.3. Réalisation simultanée des deux phases .................................................... ![]()
2.2.4. Gestion des informations ................................................................................. ![]()
2.2.5. Prélèvements liés au diagnostic 96-98 .......................................................... ![]()
2.2.6. Mise en garde relative à
l’exploitation des résultats du diagnostic
96-97 modifié ...................................................................................................... ![]()
2.2.7. Rapport .............................................................................................................. ![]()
2.3
- DISTINCTION ENTRE LES OPERATIONS
DE DESAMIANTAGE ET LES OPERATION DE MAINTENANCE ![]()
2.4 - COMITE D’APPLICATION DE LA CHARTE .................... ![]()
RESUME DES DIFFERENCES ENTRE LES DECRETS 96-97 MODIFIE ET 96-98 ![]()
L'inhalation de particules d'amiante représente un risque grave pour la
santé publique.
Le Décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la "protection de la population contre les risques sanitaires liés à
une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis", rend obligatoire
la recherche de la présence d'amiante dans les flocages et les calorifugeages
de l'ensemble des immeubles bâtis français. Seules les maisons individuelles
sont exclues du champ de ce Décret.
Le Décret 97-855 du 12 septembre 1997 complète le Décret 96.97 en
étendant la recherche aux faux plafonds.
En cas de travaux dans le bâtiment, il est précisé que la recherche de
présence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante,
effectuée dans le cadre du Décret 96-97 du 7 février 1996 modifié par le Décret
97-855 du 12 septembre 1997, ne dispense pas les propriétaires et (ou) chefs
d'établissement de leurs obligations découlant du Décret 96-98 du 7 février
1996, concernant la protection collective et individuelle des travailleurs du
bâtiment contre les risques liés à la présence d'amiante, notamment Section 1 Article 2 et Section 3 Article 27.
Les organismes habilités à effectuer la recherche d’amiante, aux termes
des-dits Décrets, sont : les contrôleurs
techniques au sens du Décret du 7 décembre 1978 et les techniciens de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission.
De nombreux professionnels se sont organisés pour entrer sur ce marché,
pour répondre à ce qui leur est avant tout apparu comme un nouveau marché. Des
offres de qualité non-homogène ont alors été identifiées et des pratiques peu
conformes à la défense de la santé publique et à l’esprit des textes ont été
enregistrées.
Compte tenu de la technicité du sujet traité et de la nécessité
d’éclairer ce nouveau marché d’un cadre clair, la Compagnie Nationale des
Experts Immobiliers (C.N.E.I.), en liaison avec les professionnels compétents,
a entrepris de mettre en œuvre un cadre visant à :
-
Expliciter et préciser les textes réglementaires, au plan technique, pour
éclairer le public, les professionnels de la construction, de l’industrie, de
l’immobilier, ainsi que les contrôleurs techniques et les techniciens de la
construction habilités à l’exécution de la recherche de présence de flocages,
calorifugeages et faux-plafonds susceptibles de contenir de l’amiante, visée
aux-dits Décrets.
-
Déterminer les modalités d'intervention dans le respect de la
législation,
-
Apporter des garanties de bonne exécution,
en proposant une Charte du
Diagnostic Amiante. ![]()
Recherche de présence de flocages,
calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante
telle que prévue aux décrets 96-97 du 7 février 1996
et 97-855 du 12 septembre 1997
- relatifs à la protection des occupants des immeubles
bâtis -
1.1. - RECHERCHE DE L’AMIANTE
PHASE 1 : Recherche de la présence de flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante.
Cette phase sera réalisée comme suit :
-
entretien préalable ;
-
inspection visuelle ;
-
prélèvements ;
-
analyses ;
-
rapport.
1.1.1. Entretien préalable
Au cours de cet entretien les obligations réglementaires applicables aux
immeubles considérés seront rappelées au propriétaire. Les besoins du donneur
d’ordre seront définis (les documents techniques et plans disponibles seront
notamment considérés). Les moyens à mettre en œuvre, les locaux concernés, les
limites de la mission et les obligations mutuelles seront précisés.
Obligations
du propriétaire :
-
Fournir les documents concernant la construction et les travaux de
rénovation de l’immeuble, s’ils existent.
-
Fournir des plans des bâtiments sur format A3 ou A4 au plus tard huit
jours avant l'intervention, s’ils existent.
-
Donner la numérotation des locaux avec les plans de repérage, s’ils
existent.
-
Prévenir les occupants ou responsables de l'exploitation de
l'intervention qui sera réalisée dans les bâtiments.
-
Désigner un représentant accompagnateur par établissement, ayant une
connaissance approfondie des lieux inspectés.
Ce représentant devra :
· posséder tous les
instruments d'accès tels que clés, codes des systèmes de contrôle d'accès et
avoir tous les pouvoirs pour pénétrer dans l'ensemble des locaux ;
· avoir accès à
l'ensemble des installations techniques pour pouvoir les arrêter si nécessaire
pendant les opérations de contrôle ;
· avoir une bonne
connaissance des procédures à respecter, pour pénétrer dans certains locaux
(salle blanche...) ;
· assurer
l'évacuation des locaux à la demande de l’intervenant si les investigations à
mener le requièrent.
-
Remettre en service les installations techniques, faisant l’objet de
consignes particulières après inspection.
-
Indiquer et faciliter l’accès à certaines zones particulières tels que
vides sanitaires, combles, plénums, gaines etc.
-
Signaler les caractéristiques inhabituelles et toutes modifications ou
incidences survenus dans les locaux depuis la dernière mise à jour des
documents techniques et diagnostics antérieurs.
Dispositions
contractuelles particulières
Sauf dispositions contractuelles
contraires, le propriétaire devra assurer :
· la mise à
disposition de moyens adaptés pour accéder à tous les secteurs concernés des
immeubles bâtis : escabeau, échelle, échafaudage, nacelle ;
· le démontage préalable
d’éventuelles trappes, capots, couvercles, nécessitant un outillage particulier
ou une procédure spécifique (pour raison de sécurité ou de consignes techniques
pour lesquelles l’intervenant n’est pas habilité).
Obligations
de l’intervenant :
-
Reporter sur le repérage des locaux, élaboré à partir des documents
graphiques donnés par le propriétaire avant l'intervention, les informations
relatives aux opérations effectuées. A défaut de remise de plan par le
propriétaire, l’intervenant assurera la traçabilité des opérations d’inspection
et de prélèvements au moyen de tous documents appropriés (schémas, croquis,
plans, description ou liste des locaux visités et non visités) qui seront
annexés au rapport.
-
Assurer l’inspection des locaux à contrôler par un personnel justifiant
d’une expérience de la construction et d’une formation appropriée. En aucun cas
il ne pourra utiliser les compétences ou les services d'un employé du
propriétaire ou des locataires, y compris l’accompagnateur (personnes ni
informées du risque, ni formées, ni protégées, ni assurées).
-
Respecter la confidentialité par rapport aux installations, plans, locaux
ou documents dont il aura pris connaissance pendant sa mission, de même pour ce
qui concerne les résultats de son intervention.
-
Ne participer en aucune manière aux travaux de traitement de l'amiante
que ce soit en tant que maître d’œuvre ou entreprise, s'il a été à l'origine du
diagnostic de l'amiante des ouvrages considérés.
-
Concernant en particulier les techniciens de la construction, justifier
d’une assurance, en cours de validité, conforme au Décret 96-97 du 7 février
1996 modifié.
Il sera alors procédé à l’établissement du protocole définissant la
prestation, les obligations respectives et le montant du marché. ![]()
1.1.2. Inspection visuelle
Conformément à l’article 2 du Décret 96-97 du 7 février 1996, modifié par
le Décret 97-855 du 12 septembre 1997, le propriétaire, après avoir vérifié l'ensemble
des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de
l'immeuble fera appel à un contrôleur technique au sens du Décret du 7 décembre
1978 ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission, pour rechercher la présence de
flocages, calorifugeages et faux plafonds.
L'inspection visuelle a pour objet de rechercher la présence de flocages,
calorifugeages et faux plafonds dans la limite de leur accessibilité, sans
sondages destructifs ni démontage de trappes d’accès ou dispositifs de
protections, nécessitant un outillage particulier ou une procédure (tel que
défini au paragraphe 11).
Toutefois les plafonds démontables seront ouverts pour une inspection des
vides sous dalles ou couvertures. Les gaines techniques accessibles et munies
de trappes de visite équipées d'un carré ou de tout autre dispositif de
verrouillage à ouverture rapide, à l'exclusion de tout accès vissé, boulonné ou
riveté, seront contrôlées. Les flocages, calorifugeages et faux plafonds
encloisonnés ne seront pas inspectés.
La prestation proposée comprend l'inspection systématique de toutes les
parties de chacun des bâtiments figurant sur les listes et les plans
communiqués par le propriétaire, à la commande. En aucun cas une notion de
vérification statistique ou par sondage ne pourra être appliquée. Les volumes
non inspectés seront expressément désignés et exclus du rapport.
Aucun sondage destructif ne sera engagé pour rechercher les matériaux ou
produits non visibles, sauf à la demande expresse du propriétaire dans le
dossier de consultation.
Pour les immeubles locatifs appartenant à un propriétaire unique,
l'inspection devra porter sur
l'ensemble de l'immeuble (hall d'entrée, circulations, cages d'escaliers,
gaines techniques et lots loués).
Pour les immeubles en copropriété, la responsabilité du syndic de la
copropriété concerne les parties communes. Les appartements devront être
inspectés à l'initiative de chaque copropriétaire.
Certaines parties communes, au sens juridique du terme, telles que
sous-faces de dalles, dispositifs de chauffage collectif, canalisations,
ventilations, gaines techniques, structure, ne sont accessibles que par les
lots privatifs. Pour la visite des parties communes, l’intervenant devra donc
avoir libre accès à l'ensemble des lots privatifs. A cet effet le syndic, tenu
par son obligation de conseil, devra informer les copropriétaires de la
nécessité d’inspection de leur lot privatif, tant pour les informer de leurs
propres obligations découlant des Décrets 96-97 et 97-855, que pour permettre
une complète inspection des parties communes accessibles par leur lot
(sous-faces de dalles, chauffage collectif éventuel, canalisations,
ventilations, gaines techniques, structure).
NB : La recherche de la présence d’autres matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sous d'autres formes que celles visées aux Décrets 96.97 du 7 février 1996 et 97-855 du 12 septembre 1997, en particulier :
· plaques de
couverture et bardage ;
· plaques
d'habillage ;
· enduits de
façades ;
· revêtements
de mur, sol et plafond ;
· peintures ;
· flocages,
calorifugeages et faux plafonds encloisonnés ou capotés, y compris les
équipements tels que chauffe-eau, cumulus, etc...
· joints de
toute nature,
n'entre pas dans le cadre de la présente mission mais pourra faire
l’objet d’une mission annexe à la demande expresse du propriétaire, dans le
cadre de dispositions contractuelles particulières. Ce diagnostic étendu
n’entre pas dans le cadre du présent chapitre de la charte.
De même la recherche d’amiante dans les flocages, calorifugeages et
faux-plafonds des parties inaccessibles ou au moyen de sondages destructifs
n'entre pas dans le cadre de la présente phase mais pourra également faire
l’objet d’une mission annexe à la demande expresse du propriétaire, dans le
cadre de dispositions contractuelles particulières. Ce diagnostic étendu
n’entre pas, non plus, dans le cadre du présent paragraphe de la charte, il est
traité au chapitre 2. ![]()
1.1.3. Prélèvements
En cas de doute, lors de l'inspection visuelle, l’intervenant effectuera un ou plusieurs prélèvements sur les flocages, calorifugeages ou faux plafonds suspects. Compte tenu de la multiplicité des compositions des matériaux fibreux et de la difficulté de garantir une reconnaissance visuelle, une vigilance particulière sera apportée à leur inspection.
L’intervenant s'engage sous sa responsabilité à effectuer le juste nombre
de prélèvements nécessaires et représentatifs de l'état des lieux, pour chaque
zone homogène (tel que défini dans l’annexe de la circulaire n° 290 du 26 avril
1996 : « parties du bâtiment présentant des caractéristiques communes
vis-à-vis de l’établissement de la cotation »).
Pour effectuer ces prélèvements, et en fonction de l’évaluation des risques, l’intervenant devra prendre toute mesure pour assurer la protection des personnes :
- évacuation
des occupants de la zone de prélèvement, y compris l'accompagnateur désigné par
le propriétaire ;
- assurer sa propre protection en fonction de l'évaluation des risques (protection individuelle : combinaison, masque, gants, etc...).
Les prélèvements seront effectués à l'aide d'un matériel de prélèvement
adapté, afin de générer le minimum de poussière, dans le respect des
prescriptions réglementaires en vigueur (article L.1 du code de la santé
publique, fixant les règles générales d'hygiène et Loi du 2 août 1961, relative
à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs).
Une imprégnation des matériaux et produits à prélever sera pratiquée
localement, pour limiter l'émission de fibres au minimum. Elle sera pratiquée
par la projection d'un produit fixatif, type vernis ou résine.
De même, le secteur prélevé sera
stabilisé après prélèvement.
Il n'est pas prévu de remise en état du secteur prélevé.
Les prélèvements seront soigneusement identifiés pour assurer la
“traçabilité” des opérations (analyse, rapport).
Les protections individuelles utilisées pour effectuer les prélèvements sont mis en quarantaine jusqu’à connaissance des résultats d’analyse. En cas de résultat positifs les protections sont stockées dans l’attente de leur acheminement dans une décharge habilitée à recevoir les matériaux contenant de l’amiante (classe 1) selon procédure des établissements classés (DRIRE).
A l’issue de l’intervention ou dans un délai maximal de dix jours ouvrés, l’intervenant s'engage à remettre au propriétaire un état des prélèvements effectués.
Le propriétaire donnera son accord sur le nombre de prélèvements jugés
nécessaires par l’intervenant, pour transmission au laboratoire, aux fins
d’analyse. ![]()
1.1.4. Analyse qualitative
des prélèvements
L'analyse des prélèvements sera assurée par un laboratoire compétent et
accrédité à partir du 1er janvier 1999.
Les prélèvements seront transmis directement par l’intervenant sous sa
responsabilité au laboratoire.
L’original des résultats d’analyses sera annexé au rapport de
l’intervenant. ![]()
1.1.5. Rapport
Au vu de l'inspection visuelle et du résultat des analyses des éventuels prélèvements,
l’intervenant rédigera un rapport de recherche de flocages, calorifugeages et
faux plafonds contenant de l’amiante.
Le rapport comprendra :
- La désignation
des immeubles visités ;
- Les données saisies
au cours de l’inspection visuelle des locaux ;
- Les schémas,
croquis, plans, descriptions ou listes des locaux visités et non visités,
permettant la traçabilité des opérations d’inspection et de prélèvements, ainsi
que la méthode de découpage en zones homogènes et leur localisation ;
- Les résultats
d'analyse des prélèvements effectués ;
- L’information des
propriétaires, quant à leurs obligations découlant des conclusions du-dit
rapport.
Ce rapport conclura sur la présence ou l’absence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante.
En
cas de présence d’amiante, le rapport donnera :
· la
localisation des matériaux ou produits contenant de l’amiante,
· les
obligations en découlant. ![]()
1.1.6. Mise en garde
L’engagement de l’intervenant ne porte que sur les seuls locaux visités.
En cas d’inaccessibilité de parties d’immeubles, les causes de leur
inaccessibilité seront décrites. En particulier, la non accessibilité de lots
privatifs, lors de la visite des parties communes d'un immeuble, entraînera
obligatoirement une restriction de la mission pour les parties non visitées.
L'attestation de présence ou d’absence de flocages, calorifugeages et faux
plafonds contenant de l’amiante sera alors limitée aux seules parties visitées.
L’attestation délivrée à l’issue de l’exécution de la mission ci-dessus décrite (limitée à la recherche de flocages, calorifugeages et faux plafonds dans la limite de leur accessibilité sans sondages destructifs ni démontage de trappes d’accès ou dispositifs de protections, nécessitant un outillage particulier ou une procédure, tel que défini au paragraphe 21), tel que prévue aux Décrets 96-97 du 7 février 1996 et 97-855 du 12 septembre 1997, ne saurait exonérer de l’obligation d’exécuter ou faire exécuter une recherche complémentaire de matériaux ou produits (supposés ou non contenir de l’amiante), avant tous travaux de nettoyage, maintenance, réparation, découpage, percements, démolition ou dépose (de faux plafonds, cloisons, revêtements, réseaux, équipements ou agencements divers) susceptibles de libérer des particules, tel que prévu au Décret 96-98 du 7 février 1996.
La
recherche de la présence de flocages, calorifugeages et faux plafonds
encloisonnés ou inaccessibles devra impérativement alors être effectuée de
manière approfondie (sondages destructifs), en même temps que la recherche de
tous matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, tel que prévu
au Décret 96-98 du 7 février 1996 (visant
à la protection des travailleurs du bâtiment), dans tous les locaux ou
zones intéressés par les-dits travaux (de nettoyage, maintenance, réparation,
découpage, percements, démolition ou dépose).
L’intervenant s’interdit toute mission de maîtrise d’œuvre découlant de
sa mission de diagnostic amiante.
Les signataires de la présente charte s’engagent à respecter et à faire
respecter les obligations définies dans le présent document. ![]()
1.2. - ETAPES ULTERIEURES
Dans le cadre du diagnostic 96-97 modifié, au-delà de la PHASE 1
(Recherche de la présence de flocages, calorifugeages et faux plafonds
contenant de l’amiante), deux étapes seront préconisées, s’il y a lieu :
- PHASE 2 : Vérification de l’état de conservation
des flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante
- PHASE 3 : Mesures d'empoussièrement (de l’air des
locaux concernés).
Les trois phases sont progressives ; le résultat d’une phase
conditionne le passage éventuel à la phase suivante.
PHASE 2 : Vérification de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante
1.2.1. Détermination des
zones homogènes
Conformément à l'article 3 du Décret 96-97 du 7 février 1996, modifié par
le Décret 97-855 du 12 septembre 1997, le propriétaire a obligation de faire
vérifier l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds
contenant de l’amiante, au moyen des grilles d’évaluation réglementaires, par
un contrôleur technique (au sens du Décret du 7 décembre 1978) ou un technicien
de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type
de mission.
Les-dites grilles d'évaluation seront établies à la demande des
propriétaires (qui resteront libre d’en confier l’établissement à l’organisme
de leur choix).
En fonction du résultat obtenu à partir des grilles d'évaluation, et conformément au Décret 96-97, du 7 février 1996 modifié, l’intervenant indiquera au propriétaire le résultat de son diagnostic et les obligations en découlant :
- soit évaluer
périodiquement l’état de conservation (tous les 3 ans) – niveau 1 ;
- soit procéder à
des mesures d’empoussièrement - niveau 2 ;
- soit réaliser des
travaux - niveau 3.
Cette évaluation
est réalisée au moyen des grilles d’évaluation standardisées et définies par
l’arrêté du 7 Février 1996.
Préalablement à
cette évaluation, l’intervenant procède à une évaluation visuelle conduisant à
la définition de zones homogènes, afin de remplir une grille d’évaluation par
zone homogène recensée.
On entend par
zone homogène une partie de bâtiment présentant des caractéristiques communes
vis à vis de l’établissement de la cotation (Annexe de la Circulaire n° 290 du
26 Avril 1996).
L’interprétation
de cette définition peut avoir une portée différente entre le début du
diagnostic amiante et au moment de l’évaluation de l’état de conservation des
matériaux.
En effet, pour la
détermination du nombre de prélèvements d’échantillons, on retient le caractère
d’uniformité du matériau, tandis que pour l’évaluation de l’état de
conservation, l’homogénéité s’entend selon les règles de construction, c’est à
dire en fonction des unités de construction (niveaux, murs de refend, cages
d’escaliers...).
Il convient
également de retenir pour le découpage des zones homogènes, le critère de
destination des locaux.
La détermination
de ces zones homogènes doit être retranscrite sur un document graphique (que
l’intervenant s’efforcera d’obtenir du propriétaire). A défaut de schémas,
croquis ou plans, des descriptions ou listes des locaux visités et non visités,
permettront la traçabilité des opérations d’inspection et de prélèvements,
ainsi que l’éclairage de méthode de découpage en zones homogènes adoptée et
leur localisation.
Les indications
portées sur les plans remis au technicien de la construction qualifié doivent
être vérifiées par ce dernier de manière à prendre en compte les modifications liées
à des restructurations ou des redistributions des locaux et afin de contrôler
les éléments de cotation des locaux concernés par la présence de matériaux
amiantifères.
La précision des
données portées sur les documents graphiques prend toute son importance dans
l’hypothèse de la nécessité de contrôler au moyen de mesures d’empoussièrement,
la concentration éventuelle en fibres d’amiante au sein des zones homogènes
considérées.
Enfin, pour
chaque zone homogène définie par le technicien de la construction qualifié
correspond une codification simple et claire.
Cette
codification sera portée sur les grilles d’évaluation correspondantes. ![]()
1.2.2. Critères d’évaluation
de l’état de conservation
Les grilles d’évaluation de l’état de conservation sont différentes en fonction des matériaux à considérer (flocages, calorifugeages, faux plafonds). Cependant les critères nécessaires à leur mise en œuvre sont identiques.
Le critère
préalable à l’évaluation est l’étanchéité à l’air.
Concernant les
grilles d’évaluation relatives aux flocages et calorifugeages ; il
convient d’appréhender un premier critère dont les conclusions déterminent
l’obligation de remplir ou non la grille.
Ce critère est
défini au sein de la première page de chaque grille et ne doit pas être
confondu avec les éléments de présentation du dossier et de la zone homogène
objets de l’évaluation.
Ce critère
consiste à évaluer l’étanchéité à l’air des écrans ou protections
éventuellement en présence au sein de la zone.
Un écran est
considéré étanche dans la mesure où il sépare de manière absolue le flocage de
la pièce, de sorte qu’il ne peut exister aucune circulation d’air.
En outre, l’écran
ne doit pas comporter d’éléments susceptibles de faire l’objet d’interventions
de maintenance susceptible de générer une circulation d’air entre le flocage et
la pièce.
La reconnaissance
d’une parfaite étanchéité à l’air dispense de remplir la grille d’évaluation et
aboutit à un résultat 1.
En revanche, les
protections autour des calorifugeages sont toujours considérées comme non
étanches même s’il s’agit d’éléments de protection encastrés de type capotage
acier ou inox.
Il est impossible
de considérer la notion d’écran pour les calorifugeages.
Concernant les
calorifugeages, cette restriction impose de remplir systématiquement la grille
d’évaluation.
La protection
physique du matériau
Il convient de définir à ce niveau la présence ou l’absence d’une protection physique du matériau sans se soucier à ce stade de l’évaluation de son niveau d’étanchéité.
·
Protection physique non étanche correspondant à la dénomination P
·
Pas de protection physique correspondant à la dénomination NP
Il est important
de ne pas confondre cette étape avec la précédente qui conditionne le remplissage
de la grille d’évaluation.
Exposition aux circulations
d’air
Trois niveaux de
classification sont retenus :
ï Forte exposition du matériau aux circulations d’air
·
Absence de système spécifique de ventilation, la zone est ventilée par ouverture
des fenêtres.
·
Le matériau est présent au sein d’un local comprenant au moins une façade
ouverte sur l’extérieur créant des situations à forts courants d‘air.
·
Présence d’un système de ventilation par insufflation d’air avec une
orientation du jet d’air affectant directement le matériau.
ï Moyenne exposition du matériau aux circulations d’air
·
Présence d’un système de ventilation par insufflation d’air avec une
orientation du jet d’air n’affectant pas directement le matériau.
·
Présence d’un système de ventilation avec reprise d’air au niveau du
flocage (système à double flux).
ï Faible exposition du matériau aux circulations d’air
·
Absence d’ouvrants ou de système de ventilation.
·
Présence d’un système de ventilation par extraction avec reprise d’air éloignée
du matériau.
Exposition aux
chocs et vibrations
Trois niveaux de
classification sont retenus :
ï Forte exposition du matériau aux chocs et vibrations
Situation dans
laquelle l’activité à l’intérieur ou à l’extérieur du local engendre des vibrations
ou provoque des chocs directs avec le matériau (Hall industriel, machines-outils, gymnases, discothèques ....).
ï Moyenne exposition du matériau aux chocs et vibrations
Matériau localisé
dans un local très fréquenté mais non exposé aux dommages mécaniques
(Supermarchés, piscines, théâtres, ....).
ï Faible exposition du matériau aux chocs et vibrations
Le matériau n’est
pas exposé aux dommages mécaniques, ne peut être dégradé directement par les
occupants (accès direct à > de 3 mètres) ou est localisé au sein d’un local
utilisé à des activités tertiaires passives.
![]()
1.2.3. Obligations inhérentes
à l’évaluation
L’Article 4 du
Décret n° 96-97 du 7 Février 1996 modifié par le Décret n° 97-855 du 12
septembre 1997 dispose qu’en fonction des résultats obtenus à partir des
éléments de la grille d’évaluation de l’état de conservation des flocages,
calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante, trois résultats sont
possibles et imposent des obligations aux propriétaires ; à savoir :
Résultat 1 - Le propriétaire doit procéder à un contrôle
périodique de l’état de conservation des matériaux dans les mêmes conditions
définies ci avant dans un délai de trois ans ou à l’occasion de toute modification
substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Ce délai court au
moment de la remise au propriétaire des résultats du diagnostic amiante.
Résultat 2 - Le propriétaire doit procéder à une surveillance du
niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère de la zone considérée de manière à
déterminer la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l’air.
Aucun délai n’est
réglementairement imposé pour mettre en application cette disposition. Toutefois,
il est conseillé au propriétaire d’entreprendre cette démarche au plus tôt
après la remise par le technicien chargé du contrôle des résultats du
diagnostic amiante sans dépasser le délai de douze mois (délai de référence
imparti pour procéder à des travaux de désamiantage).
Résultat 3 - Le propriétaire doit procéder à des travaux
appropriés dans un délai de douze mois après communication des résultats du
diagnostic amiante. ![]()
PHASE 3 : Réalisation du contrôle du niveau d’empoussièrement des locaux contenant des flocages, calorifugeages et faux plafonds amiantes.
1.3.1. Mesures
d’empoussièrement
Les mesures d'empoussièrement de l’atmosphère des immeubles bâtis qui pourraient être rendues nécessaires, après vérification de l'état de conservation des matériaux et produits (cf. § 3.1. – niveau 2), se déroulent en deux étapes :
- prélèvement d’air,
- comptage des particules.
Ces opérations seront réalisées par un organisme agréé.
L’intervenant déterminera au préalable le nombre de prélèvements jugés nécessaires. Le propriétaire donnera son accord sur le nombre des prélèvements et comptages de particules, jugées nécessaires par l’intervenant.
L’intervenant informera le propriétaire :
- des résultats des comptages de particules,
- des obligations en découlant.
Les mesures
d’empoussièrement réalisées consécutivement à l’obtention d’un résultat 2
correspondant à l’évaluation de l’état de conservation des flocages,
calorifugeages et faux plafonds, permettent de déterminer le nombre de fibres
d’amiante en suspension dans l’atmosphère de la zone homogène.
Ce type de mesure
constitue la seule manière de caractériser objectivement le risque amiante au
sein d’un local ou d’un bâtiment dans la mesure où la présence d’amiante telle
qu’elle a pu être détectée lors du diagnostic amiante ne constitue qu’une
simple présomption de contamination.
Pour ce faire, il
convient de prélever conformément aux exigences réglementaires. Ces dernières
régissent un mode de prélèvement permettant de se rapprocher le plus fidèlement
possible à l’exposition d’un individu pendant une durée définie.
C’est la raison
pour laquelle, il s’agit de prélever au moins la fraction thoracique à une
hauteur comprise entre 1,50 et 2,00 mètres pendant une période comprise entre
24 et 40 heures. ![]()
1.3.2. Organismes habilités à
procéder aux prélèvements d’air dans les immeubles bâtis
Les prélèvements
d’air sont effectués par des Laboratoires ou Bureaux d’Etudes agréés en
application de l’Arrêté du 1 Février 1999 relatif à l’agrément d’organismes
habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante
dans l’atmosphère des immeubles bâtis.
Les conditions de
délivrance d’un agrément pour procéder aux prélèvements d’air sont soumises à
l’obligation pour le bureau d’études, d’être accrédité par le Comité Français
d’Accréditation dans le cadre de son Programme 144.
Le prélèvement doit s’effectuer selon
les exigences de la norme NF X 43 050. ![]()
1.3.3. Conditions de
prélèvement
Le degré
d’activité dans les locaux et la présence de vibrations dues à des machines ou
appareils sont des facteurs pouvant influencer grandement les concentrations en
fibres d’amiante mesurées.
Ces facteurs devront donc être pris en compte durant le prélèvement. Un
prélèvement d’une durée de cinq jours, pendant les périodes d’activité dans le
local permet d’intégrer et donc d’établir la pollution moyenne, suite à un
nombre important d’épisodes polluants.
Ainsi, il est d’usage de procéder
selon une des deux façons suivantes :
·
Soit le pompage peut s’effectuer pendant 8 Heures par jour sur cinq jours
avec un débit de 5 Litres/Minute (+/- 0,5L/mn).
Le pompage est
programmé de manière à être effectué pendant les heures ouvrables c’est à dire
d’intense activité provoquant des mouvements d’air.
·
Soit, le pompage peut s’effectuer en continu, sur une durée comprise
entre 24 Heures minimum et 36 Heures maximum, lorsque le local est occupé en
permanence ou lorsque le local est inoccupé.
En application des recommandations du Programme 144 du COFRAC, le
technicien chargé du contrôle effectue un nombre de prélèvements qui est
fonction de la surface considérée :
·
1 Prélèvement pour une surface inférieure à 250 m²,
·
2 Prélèvements pour une surface comprise entre 250 et 500 m²,
·
3 Prélèvements pour une surface comprise entre 500 et 1 000 m²,
·
4 Prélèvements pour une surface comprise entre 1 000 et 10 000 m²,
·
5 Prélèvements pour une surface supérieure à 10 000 m².
La notion de surface de la zone homogène considérée, objet des
prélèvements d’air, rappelle l’importance d’un découpage et d’un métrage précis
et judicieux des zones homogènes.
Ainsi, les surfaces des zones conditionnent le nombre de prélèvement a
effectuer.
En outre, le technicien chargé du contrôle doit s’appliquer à apprécier
objectivement la destination, l’occupation et la pollution (atmosphère chargée
en poussières) des locaux de façon à déterminer un mode de pompage en terme de
temps et de débit permettant d’optimiser la précision des résultats des
analyses et de se conformer le plus fidèlement possible à la réalité du site. ![]()
1.3.4. Comptage des fibres
d’amiante
Les filtres de prélèvement doivent ensuite être transmis à un laboratoire
agréé aux fins de procéder au comptage des fibres d’amiante.
Les conditions de transfert des échantillons d’air nécessitent
l’application stricte de mesures de protection des filtres afin de rendre
optimales les conditions d’analyses.
Le laboratoire
procède à l’analyse de la tête de prélèvement au moyen de la Microscopie
Electronique à Transmission.
Cette technique correspond au procédé d’analyse le plus performant
concernant la recherche d’amiante, puisqu’elle bénéficie d’un degré de
résolution de 0,01 µm, résolution suffisante pour repérer tous types de fibres
d’amiante. ![]()
1.3.5. Obligations
inhérentes aux résultats des mesures d’empoussièrement
En fonction du nombre de fibres d’amiante détectées par litre d’air, le propriétaire est astreint à des obligations différentes conformément aux dispositions de l’Article 5 du Décret 96-97 du 7 Février 1996, modifié par le Décret 97-855 du 12 Septembre 1997
·
Soit le niveau d’empoussièrement est inférieur à 5 fibres d’amiante par
litre d’air, dans ce cas le propriétaire doit procéder à un nouveau contrôle de
l’état de conservation du matériau dans un délai de trois ans ou à l’occasion
de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
·
Soit le niveau d’empoussièrement est compris entre 5 et 25 fibres
d’amiante par litre d’air, dans ce cas le propriétaire doit procéder à un
nouveau contrôle de l’état de conservation du matériau dans un délai de deux
ans ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son
usage.
·
Soit le niveau d’empoussièrement est supérieur à 25 fibres d’amiante par
litre d’air, dans ce cas le propriétaire doit procéder à des travaux appropriés
dans un délai de douze mois.
En fonction des résultats obtenus, le
technicien chargé du contrôle s’efforce d’informer le propriétaire sur ses
obligations réglementaires, notamment en ce qui concerne son devoir de
publicité auprès des occupants du site et toute personne amenée à effectuer des
travaux de nettoyage, maintenance ou entretien dans la zone contaminée.
En outre, les dispositions du Décret
n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection es travailleurs contre les
risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante précise les conditions de
traitement de l’amiante en place en terme de protection individuelles et
collectives.
Ce texte soumet également à un
recensement obligatoire de tous les types de matériaux susceptibles de contenir
de l’amiante dans l’hypothèse d’engagement de travaux uniquement pour la zone
objet des opérations de réhabilitation ou de démolition.
La recherche complémentaire de matériaux ou produits contenant de
l’amiante, avant tous travaux, tel que prévu au Décret 96-98 du 7 février 1996,
fera également l’objet d’un document spécifique. ![]()
Recherche étendue de présence de l’amiante dans tous les
matériaux y compris non accessibles
telle que prévue au décret 96.98 du 7 février 1996
- relatif à la protection des travailleurs contre les
risques liés à l’inhalation d’ poussières d’amiante dans les immeubles bâtis-
CADRE
PREALABLE AU DECRET 96-98
Le volet réglementaire relatif à la protection des travailleurs contre le risque amiante existe depuis de nombreuses années. En effet, les dispositions du Décret n° 77-949 du 17 Août 1977 déterminaient un processus que la réglementation actuelle ne fait que renforcer :
· Obligation d’évaluer le risque amiante,
· Respect des valeurs limites
d’exposition,
· Mesures de protections individuelles et
collectives,
· Information obligatoire des personnels,
· Suivi médical obligatoire des
travailleurs exposés.
Malgré un champ
d’application clair de ce texte, puisqu’il concernait sans restriction l’ensemble des établissements industriels,
commerciaux et agricoles, donc les entreprises du bâtiment, il faut bien
reconnaître que pendant vingt ans, la réglementation de la protection des
travailleurs de l’amiante n’a été réellement appliquée que dans les industries
directement dédiées à la production, au traitement ou à la mise en œuvre de l’amiante.
Or, les constations
du corps médical montrent clairement que les victimes de l’amiante ne sont pas
uniquement issues des professions de l’industrie de l’amiante.
En effet, de nombreux
cas de cancer touchent les professionnels du bâtiment qui lors de leurs
interventions classiques, ont pu solliciter des matériaux amiantifères et donc
inhaler des fibres d’amiante. Il s’agit des électriciens, des chauffagistes,
des plombiers, des couvreurs, des maçons dans le cadre d’opérations de
nettoyage, maintenance, réparation, rénovation, découpage, percement,
démolition ou dépose.
RENFORCEMENT
DES TEXTES
Ainsi, le nouveau cadre réglementaire dans le domaine de la protection des travailleurs est représenté par le Décret n° 96/98 du 7 Février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient
d’ailleurs, de bien distinguer le Décret n° 96-97 modifié relatif à la
protection de la population (Occupation passive des bâtiments) du Décret n°
96/98 relatif à la protection des travailleurs et en particulier, les
travailleurs du bâtiment.
Le Décret n° 96/98 du
7 Février 1998 poursuit deux objectifs :
· Renforcer les seuils relatifs à
l’exposition des travailleurs (valeurs limites),
· Etendre le champ d’application de la
protection des travailleurs au delà des seules activités industrielles (Secteur
Construction / Réhabilitation / Maintenance).
Ainsi, cette
réglementation concerne d’une part, les chantiers de traitement de l’amiante en
place et, d’autre part, concerne également toutes les activités d’intervention
sur des matériaux et matériels susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
Les dispositions du
Décret n°96/98 du 7 Février 1996 régissent trois secteurs distincts :
· Secteur 1 : Les activités de
fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante.
· Secteur 2 : Les activités de
confinement et de retrait de l’amiante dans le bâtiment
· Secteur 3 : Le diagnostic
préalable aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils
susceptibles d’émettre des fibres d’amiante.
![]()
2.1 - OBJET DE LA PRESENTE CHARTE, relative au Décret 96-98
La présente Charte est destinée à expliciter
les textes réglementaires et encadrer l’intervention des Experts en hygiène,
sécurité et environnement, les Techniciens du bâtiment et Contrôleurs
techniques, dans le cadre de leurs activités de diagnostic amiante tous
matériaux, dans l’ensemble des immeubles bâtis français, sans exclusive.
En effet, si le
Décret 96-97 modifié exclut les immeubles bâtis affecté à l’usage d’un seul
logement, il n’en est pas de même pour l’article 96-98 qui concerne l’ensemble
des immeubles bâtis français
Aussi, ce sont les
seuls aspects méthodologiques et déontologiques du Décret n° 96/98 du 7 Février
1996 qui sont développés pour ce qui concerne l’utilisation de l’amiante dans
la construction.
Le domaine
d’application de l’Article 27 du Décret n° 96/98 est précis. Il s’agit
d’activités ou d’interventions dont la finalité n’est pas de désamianter, mais
susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.
En
l’occurrence, cela concerne toutes les aux opérations de nettoyage,
maintenance, réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose
qui tendraient à solliciter ou à enlever des matériaux contenant de l’amiante.
L’objectif de ce Décret 96-98 étant de protéger les travailleurs.
Pour toutes ces
activités ou interventions, l’Article 27 précise que le chef d’établissement,
dans le cadre de l’évaluation des risques, est tenu de s’informer de la
présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments concernés avant toute
opération de nettoyage, maintenance ou entretien.
Cette exigence
réglementaire précise que, préalablement à tous travaux de nettoyage,
maintenance, réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou
dépose, le chef d’établissement doit mettre en œuvre tous les moyens dont il
dispose, pour repérer des matériaux amiantifères, évaluer les risques, de
manière à définir un mode opératoire susceptible de protéger les travailleurs
et la population en présence éventuellement à proximité des lieux
d’intervention. ![]()
2.2. - RECHERCHE ETENTUE DE L’AMIANTE / Décret
96-98
Une exigence de plus en plus vive pèse
sur les chefs d’établissements, quant à l’administration des actifs
immobiliers, et cela à deux niveaux différents :
-
En terme de
responsabilité, en matière d’hygiène, santé, sécurité, pollution,
environnement, d’une part,
-
En terme de
performance de l’outils immobilier et d’optimisation des dépenses d’entretien
et gros travaux, d’autre part.
Ainsi, les propriétaires, les chefs
d’établissement ou les exploitants souhaitent de plus en plus se prémunir
contre les risques engageant leur responsabilité et planifier les dépenses
inhérentes à la gestion de leurs biens.
Aussi, est-il demandé par les chefs
d’établissement, la réalisation de diagnostics étendus (exhaustifs) préventifs
des bâtiments, visant :
-
D’une part, à
recenser les menaces en terme d’hygiène, santé, sécurité et environnement (et
en particulier amiante), et ainsi à dégager la responsabilité (civile et
pénale) du chef d’établissement ;
-
D’autre part,
d’optimiser les dépenses, par l’identification préventive des désordres à
caractère évolutif, permettant une planification des charges liées aux
événements accidentels, comme à l’entretien courant et les gros travaux. ![]()
2.2.1. DIAGNOSTIC 96-98 - 1ère
PHASE
RECHERCHE EXHAUSTIVE DE L’AMIANTE VISIBLE ET ACCESSIBLE
Le diagnostic 96-98 est souvent décomposé en deux phases. La première doit permettre aux propriétaires d’avoir une connaissance globale de leurs bâtiments dans une logique de prévention par rapport aux activités courantes de nettoyage, petites réparations, percement et maintenance. Dans la mesure où ces activités sont fréquentes au sein d’un bâtiment, la possibilité de solliciter un matériau amiantifère est permanente.
Les informations
inhérentes aux résultats du diagnostic amiante en application des dispositions
du Décret n° 96-97 du 7 Février 1996 modifié, relatif à la protection de la
population (occupation passive) sont insuffisantes.
Effectivement, il est
nécessaire pour le personnel en charge des opérations de nettoyage, réparation
et maintenance, de localiser les matériaux amiantifères autres que les seuls
flocages, calorifugeages et faux plafonds.
Ainsi, le chef
d’établissement, dans le cadre d’une politique de prévention du risque amiante,
se doit de faire engager par un organisme compétent, une recherche de tous les
matériaux visibles et accessibles, susceptibles de contenir de l’amiante.
L’aboutissement de
cette mission se concrétise par la remise d’un rapport, indiquant la
localisation de tous les matériaux amiantifères identifiés au sein d’un site.
L’exploitation de ce
type de document doit être permanente et automatique. Il s’agit notamment de
communiquer ces éléments à l’ensemble du personnel chargé des petites
interventions au sein du bâtiment.
En outre, la
communication de ce document à toute entreprise extérieure amenée à intervenir
dans le bâtiment, dans le cadre d’opérations légères (telles que nettoyage,
maintenance, réparation) s’avère indispensable.
Un diagnostic
96/98 au titre de la PREMIERE PHASE se doit d’être complet.
Ce type
d’intervention est identique dans sa démarche à celle entreprise dans le cadre
du diagnostic 96-97. La différence concerne les matériaux à repérer. Le
diagnostic 96-98 PREMIERE PHASE se veut exhaustif sans dérogation possible.
Cependant,
dans l’optique de ne pas détériorer le bâtiment, les recherches se limitent aux
seuls éléments d’ouvrages visibles et accessibles.
L’amiante a
été utilisé dans les matériaux de construction principalement pour ses
propriétés de résistance au feu, d’isolation phonique et thermique,
résistance mécanique et aux agressions chimiques etc.
Dans le
bâtiment, les points a vérifier sont par conséquent nombreux :
De par sa
résistance au feu et aux agressions chimiques sont ainsi concernés les plaques
de carton amiante (tels que le Panocell) et les enduits de plâtre amiantifère.
De par sa
résistance mécanique, sont également concernés les éléments amiante ciment
(tels que le Fibrociment). C’est-à-dire, les plaques, boisseaux et leurs
dérivés.
· Toutes les pièces et points chauds
comme les chaufferies, les cuisines, les protections (mobiles ou non) arrières
de radiateurs, les joints de colmatage, les protections arrières de cheminées,
les gaines techniques, les portes coupe feu, les clapets coupe-feu.
· Les éléments en amiante ciment (ou
Fibrociment) ont fait l’objet d’applications multiples.
· Les éléments de canalisation, les
plaques de toiture et de bardage, les boisseaux et conduits divers, les plaques
de séparation d’étages ou de gaines, les allèges et appuis de fenêtres,
certaines cloisons, certaines plaques de faux plafonds fixes ou démontables.
· Les revêtements de sol sont également
largement concernés par ces recherches à caractère exhaustif, avec notamment
les dalles plastiques ou vinyles, lés en vinyle ainsi que tous les éléments de
supports, à savoir les colles.
· Enfin, les peintures, les enduits, les
crépis sont également impliqués et susceptibles de contenir de l’amiante. ![]()
2.2.2. DIAGNOSTIC 96-98 - 2ème PHASE AVANT TRAVAUX
IMPLIQUANT des SONDAGES DESCTRUCTIFS
Cette seconde
phase doit être préalable à chaque programme de réhabilitation, rénovation,
découpage, percement, démolition ou dépose au sein d’un bâtiment.
A partir du moment où
ce type de travaux est planifié, le chef d’établissement doit prendre la
précaution de faire repérer tous les matériaux amiantifères, visibles et
encoffrés, accessibles ou non accessibles, ainsi la réalisation de prélèvements
s’impose.
L’étendue de ces
investigations peut être limitée aux seules zones objets des futurs travaux.
Le recensement de
matériaux amiantifères dans la future zone de travaux enclenche une procédure
d’évaluation du risque pour les entreprises appelées à intervenir.
Deux hypothèses sont alors possibles :
· Soit, il s’agit de déposer un matériau
friable ce qui implique l’application de la section 1 de l’Arrêté du 14 Mai
1996, relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises
effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante.
· Soit, il s’agit de déposer des
matériaux non friables ; ce qui implique l’application de la section 2 de
l’Arrêté du 14 Mai 1996, relatif aux règles techniques que doivent respecter
les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de
l’amiante.
Dans les deux
cas, l’entreprise chargée des opérations de retrait de l’amiante doit, en
application de l’Article 23 du Décret n° 96/98, établir un plan de retrait,
soumis un mois avant le commencement des travaux, aux organismes de prévention.
Le diagnostic
96/98 SECONDE PHASE doit être complet. Or, la réalisation d’un diagnostic 96-98
SECONDE PHASE impose la mise en œuvre d’un processus différent de celui
appliqué dans les recherches relevant du Décret 96-97 modifié ou celles
relevant du diagnostic 96-98 PREMIERE PHASE.
Le but de ce
type d’investigation consiste à repérer tous les matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante, visibles ou non visibles, accessibles ou non
accessibles.
Il s’agit en
effet de déterminer si les interventions ultérieures des entreprises chargées
de travaux de réhabilitation, rénovation, découpage, percement, démolition ou
dépose dans les zones objets des investigations, peuvent comporter un risque en
terme de présence de matériaux amiantifères.
De manière à
assurer l’exhaustivité des recherches et d’en limiter le coût notamment en
terme de volume d’échantillons à soumettre à analyse par un Laboratoire, il est
possible de limiter les investigations aux seules zones faisant l’objet
d’opérations de réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou
dépose.
Il convient
notamment de repérer les matériaux non visibles, c’est à dire ceux encoffrés et
ceux localisés au sein de zones inaccessibles. Par conséquent, le démontage de
certains éléments de construction et la réalisation de prélèvements destructifs
s’imposent. ![]()
2.2.3. REALISATION
SIMULTANEE DES DEUX PHASES
La décomposition du
diagnostique 96-98 en deux phases correspond à une démarche préventive, en terme
de protection des travailleurs, en évitant de détériorer un bâtiment par la
mise en œuvre de prélèvements destructifs, lors de la première phase.
Il est
cependant possible pour un propriétaire de confondre ces deux phases et de
faire effectuer ces deux missions simultanément, dans l’hypothèse d’une
programmation imminente de travaux de réhabilitation, rénovation, découpage,
percement, démolition ou dépose. ![]()
2.2.4. GESTION DES
INFORMATIONS
Une cartographie détaillée de chaque
bâtiment doit être réalisée. Certains cabinets d’expertise et bureaux d’études
proposent de rendre cette cartographie accessible à travers des logiciels
spécifiques. Ces logiciels permettent de gérer à la fois les informations
techniques, les éléments économiques liés aux provisions financières à passer,
ainsi qu’une cartographie 3D. ![]()
2.2.5. PRELEVEMENTS LIES AU
DIAGNOSTIC 96-98
Au
même titre qu’un diagnostic flocages, calorifugeages et faux plafond, lorsqu’un
doute subsiste quant à la nature du matériau, il convient de réaliser des
prélèvements d’échantillons solides afin de les soumettre à analyse à un
laboratoire habilité.
Les
conditions de prélèvements d’échantillons, en terme de mesures de protection,
sont conformes à celles respectées lors de la réalisation des diagnostics 96-97
modifié (occupation passive) – voir ce chapitre.
Cette phase se
déroule de manière à éviter tout risque de contamination pour :
· Les occupants du site et personnels
accompagnant les techniciens,
· Les techniciens qualifiés,
·
L’outillage
des techniciens qualifiés,
·
L’ensemble du
site, objet du diagnostic.
Les moyens de protections individuels des intervenants sont identiques à ceux utilisés dans le cadre du Décret 96-97 modifié.
Le
conditionnement des échantillons prélevés s'effectue avec la plus grande
vigilance pour :
· Eviter une contamination de la pièce
· Eviter une contamination de l'opérateur
· Eviter une contamination de l'outillage
· Eviter une pollution croisée
Le Comité Français d’Accréditation
articule, dans son Programme 144 concernent les prélèvements d’échantillons
solides friables, les recommandations suivantes :
-
Préparation du
matériau :
"
Application de surfactant sur une surface de 500 cm² environ autour du point de
prélèvement ".
-
Prélèvement :
" Par
carottage ou par flacon échantillonneur. Les dimensions sont les
suivantes : diamètre de 2 à 5 cm. Lorsque l’échantillon est prélevé par
carottage, il est placé dans un sac plastique étanche et résistant. Chaque
contenant d'échantillon porte un repérage indélébile permettant son
identification, en correspondance avec la fiche de prélèvement ".
-
Après
prélèvement :
"
Application de surfactant sur la cicatrice ".
-
Protections et
précautions :
" Un soin
particulier sera apporté aux carottages successifs, afin d'éviter toute
pollution croisée.
Le
prélèvement s'effectue en zone inoccupée et le point de prélèvement est choisi
de manière à conduire à une pollution minimale de la zone. En cas
d'endommagement significatif causé par le prélèvement, avec en particulier
émission de poussières, un nettoyage de la zone sera réalisé.
-
Fiche de
prélèvement :
" Une
fiche de prélèvement comportant les informations nécessaires est établie. Elle
accompagne chaque échantillon. ".
Concernant, les matériaux non friables, les mesures de protection à mettre en œuvre sont moins rigoureuses, on doit tout de même prendre la précaution de limiter au maximum les risques pour les techniciens chargés du contrôle et pour les occupants du site objet des recherches.
Dans le cadre
d’un diagnostic tous matériaux, il n’est pas indispensable de prélever les
matériaux dont la composition en amiante est connue, notamment les éléments en
amiante ciment ou Fibrociment qui, sauf rares exceptions, contiennent tous de
l’amiante.
Concernant les
revêtements de sols, il convient de prélever également des échantillons du
support et de la colle.
Concernant les
revêtements en plâtre, le technicien chargé du contrôle doit distinguer les
plâtres remplissant une fonction de protection coupe feu, de ceux n’ayant qu’un
rôle d’enduit.
Dans la
première hypothèse, il convient de réaliser systématiquement des prélèvements,
dans la seconde hypothèse, le risque de rencontrer de l’amiante est très
faible. ![]()
2.2.6.
MISE EN GARDE RELATIVE A L’EXPLOITATION DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC
96-97 modifié
préalablement aux opérations de nettoyage, maintenance,
réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose
L’obtention
des résultats des recherches effectuées au titre du Décret n° 96-97 du 7
Février 1996 modifié, permet uniquement d’être informé quant à la présence ou
l’absence de flocages, calorifugeages et faux plafonds amiantifères visibles et
accessibles (sans sondages destructifs).
En outre, les
dispositions du Décret n° 96-97 excluent de leur domaine d’application les
immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement, à savoir, les
maisons individuelles.
Ainsi,
deux problèmes majeurs se posent pour une entreprise appelée à réaliser des
travaux de nettoyage, maintenance, réparation, rénovation, découpage,
percement, démolition ou dépose, au sein d’un bâtiment :
-
Le premier
concerne l’étendue des recherches effectuées lors du diagnostic amiante en
application du Décret n° 96-97 modifié. Dans la mesure où seulement trois types
de matériaux ont été obligatoirement recensés, le chef d’établissement n’a
aucune information concernant les types de matériaux autres que les flocages,
calorifugeages et faux plafonds.
Par conséquent le chef d’établissement, en application du point 2 de l’Article 27 du Décret n° 96/98 se doit d’évaluer par tout autre moyen approprié au type d’intervention, le risque éventuel de présence d’amiante sur les équipements ou installations concernés.
-
Le second
problème est relatif aux interventions au sein des maisons individuelles. Dans
la mesure ou la réalisation des diagnostics amiante n’est pas obligatoire au
titre du Décret n° 96-97 modifié, le chef d’établissement ne dispose d’aucune
information quant à la présence ou l’absence de matériaux contenant de
l’amiante. ![]()
2.2.7. RAPPORT
Le support
relatif à la présentation d’un diagnostic tous matériaux demeure le rapport
d’intervention. Il convient de mettre en œuvre tous les moyens utiles
permettant de présenter avec clarté la nature et la localisation des matériaux
amiantifères.
A défaut de
remise de plan par le propriétaire, l’intervenant assurera la traçabilité des
opérations d’inspection et de prélèvements au moyen de tous documents
appropriés (schémas, croquis, plans, description ou liste des locaux visités et
non visités) qui seront annexés au rapport.
Ce document a
ensuite vocation à être communiqué à l’ensemble des entreprises ou personnes,
susceptibles d’intervenir dans le cadre d’opérations de nettoyage, maintenance,
réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose, dans les
zones ayant fait l’objet du diagnostic tous matériaux. ![]()
2.3. - DISTINCTION ENTRE LES OPERATIONS DE DESAMIANTAGE ET LES OPERATIONS DE MAINTENANCE
La présente charte a pour finalité
d’éclairer les techniciens de la construction qualifiés et contrôleurs
techniques dans la réalisation de leurs opérations de diagnostic amiante.
Toutefois, ces professionnels ont le
devoir de conseiller les chefs d’établissements.
Il existe en effet une ambiguïté
apparente, dans les textes - et il convient de faire une distinction - entre
les opérations de confinement et de retrait de l’amiante (régies par la section
2 du Décret n° 96/98) des opérations sur des matériaux amiantifères (régies par
la section 3 du Décret).
Or, l’Article 27 du Décret n° 96/98
précise clairement que les activités soumises au secteur 3 sont celles dont la
finalité n’est pas de traiter l’amiante mais susceptibles de provoquer
l’émission de fibres d’amiante.
Tandis que l’Article 23 précise que les
activités de la section 2 ont pour finalité le retrait ou le confinement de
l’amiante.
Le problème concerne le niveau
d’intervention correspondant au seuil de distinction d’une simple opération de
nettoyage, maintenance ou entretien à une opération dont la teneur s’apparente
à une opération de retrait.
La distinction est importante,
notamment pour le processus à suivre en fonction du secteur d’intervention.
Pour les activités de retrait de
l’amiante, l’entreprise doit rédiger un plan de retrait décrivant le mode
opératoire retenu et les moyens de protection mis en œuvre. Ce document
est transmis un mois avant le commencement des travaux aux organismes de
prévention.
Pour les activités relevant de la section
3, la rédaction d’un plan de retrait n’est pas exigée.
On peut considérer qu’à partir du
moment où une opération de maintenance aboutit à la dépose totale de matériaux
contenant de l’amiante, il faut considérer que la dite intervention relève de
la section 2. ![]()
2.4. - COMITE D’APPLICATION DE LA CHARTE
Il a été décidé, entre les partenaires à la rédaction de la Charte la mise en place d’un comité d’application de la Charte, d’observation des pratiques et de médiation.
Cette instance a été baptisée Haut Comité d’Ethique de l’Amiante.
Le 7 mai 1999, le Haut Comité d’Ethique de l’Amiante s’est réuni dans les bureaux des Laboratoires PROTEC, à PALAISEAU (91).
- Benoît PETIAU (société L.E.I.), représentait le collège des techniciens du bâtiment, habilités à la recherche de l’amiante dans les immeubles.
-
Pavel STREBER
(Laboratoires PROTEC à PALAISEAU) représentait le collège des laboratoires d’analyses agréés dans le
domaine de l’amiante,
-
Philippe LAMY
(membre du Haut Collège International des
Experts / expert assermenté près la Cour Administrative d’Appel / P.D.G. de
LAMY S.A. expertise),
représentait la CNEI (Compagnie Nationale des Experts Immobiliers), en qualité
de Vice-Président et la Chambre Nationale d’Arbitrage et de Médiation, en tant
que Secrétaire Général.
Le Haut Comité d’Ethique de l’Amiante
a pour finalité de traiter les litiges déclarés (ou à naître), suite à de la
publication de la Charte du Diagnostic Amiante, établie sous l’autorité
scientifique et la responsabilité technique de la CNEI, en liaison avec les
pouvoirs publics et les grands noms de l’expertise et du contrôle techniques,
concernant l’exercice du diagnostic amiante (tel que découlant des Décrets
96-97 et 96-98). Son action se rattache à celle du Centre Européen de Médiation
de la Construction et de l’Immobilier, qui réunit en France, sous l’égide de la
Chambre Nationale d’Arbitrage et de Médiation (voir site CNAM http://www.mediation-cnam.org),
les notaires, les architectes et les experts immobiliers dans le traitement de
l’ensemble du contentieux immobilier et technique.
La Charte du Diagnostic Amiante met en
évidence un certain nombres de points de doctrine et d’exigences techniques,
liées à ces Décrets, souvent mal compris. Des insuffisances de qualités
caractérisées ont été relevées dans les prestations des diagnostiqueurs, dans
une proportion alarmante. Il est ainsi à redouter qu’un certain nombre de
diagnostics, exécutés antérieurement aux précisions ministérielles et à la
publication de la Charte, aient été effectués dans des conditions de qualité
insuffisante. Il est alors probable que les propriétaires, disposant
d’attestations ne présentant qu’une garantie incertaine, souhaiteront un
complément d’investigations.
Afin de ne mettre en difficulté, ni ces
derniers ni les sociétés de diagnostic, il est proposé que le Haut
Comité d’Ethique de l’Amiante soit saisi de tout litige et recherche
un accord entre les parties, en sorte qu’un complément d’investigations puisse
être effectué dans les meilleures conditions économiques pour les deux parties.
En cas de défaillance de la part des
diagnostiqueurs ou d’incapacité à compléter leur prestation, le Haut
Comité d’Ethique de l’Amiante pourra avoir pour fonction la
recommandation d’un nouveau prestataire (et, si nécessaire, l’encadrement de
son intervention).
Enfin, tout litige ou contentieux à
naître dans les années à venir dans le cadre général de la Charte du Diagnostic
pourra être abordé par un médiateur spécialement formé, intervenant dans une
phase pré-contentieuse sous l’autorité du Haut Comité d’Ethique de l’Amiante
et sous l’égide de la CNAM (Chambre Nationale d’Arbitrage et de Médiation).
Il est précisé que l’adhésion à la
Charte du Diagnostic Amiante est une démarche individuelle et volontaire. Ainsi
ne pourront se réclamer du label « adhérant à la Charte du Diagnostic
Amiante de la C.N.E.I. » que les professionnels acceptant le principe
du contrôle de leurs procédures et du mode effectif d’exercice de leur
activité, par le Haut Comité d’Ethique de l’Amiante.
Le Haut Comité d’Ethique de l’Amiante
est constitué sous l’égide de la CNEI, en liaison avec la Chambre Nationale
d’Arbitrage et de Médiation. Toute demande d’adhésion devra être adressée à la
CNEI : 18, rue Volney 75002 Paris
(Tél. 01 44 07 19 57).
RESUME DES DIFFERENCES
ENTRE
LES
DECRETS 96-97 modifié ET 96-98
Le diagnostic amiante en
application du Décret n°96-97 modifié, concerne les flocages, calorifugeages et
faux plafonds visibles et accessibles.
Le
diagnostic est effectué au moyen d’une visite accessible des locaux (seul moyen
d’établir des zones homogènes). Les prélèvements sont ensuite effectués, si
nécessaire, dans chaque zone homogène (clairement définie). Toute approche
théorique ou statistique du risque est donc bannie.
Ainsi, pour les immeubles
locatifs appartenant à un propriétaire unique, l'inspection porte sur
l'ensemble de l'immeuble (hall d'entrée, circulations, cages d'escaliers,
gaines techniques et lots loués). Pour les immeubles en copropriété, la
responsabilité du syndic de la copropriété concerne les parties communes et les
appartements sont inspectés à l'initiative de chaque copropriétaire. Certaines
parties communes, au sens juridique du terme, telles que sous-faces de dalles,
dispositifs de chauffage collectif, canalisations, ventilations, gaines
techniques, structure, ne sont accessibles que par les lots privatifs.
L’intervenant devra donc avoir libre accès à l'ensemble des lots privatifs.
Le diagnostic relevant de ce premier Décret procède d’un
examen visuel des matériaux visibles et accessibles ; il exclut donc les
sondages destructifs.
Le diagnostic amiante
tous matériaux ou diagnostic étendu, réalisé en application du Décret n° 96/98,
concerne tous les matériaux.
Il
est préalable à toutes opérations de nettoyage, maintenance, réparation,
rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose. La recherche approfondie de tous les matériaux
susceptibles de contenir des particules d’amiante est ici opérée au moyen de sondages destructifs. ![]()